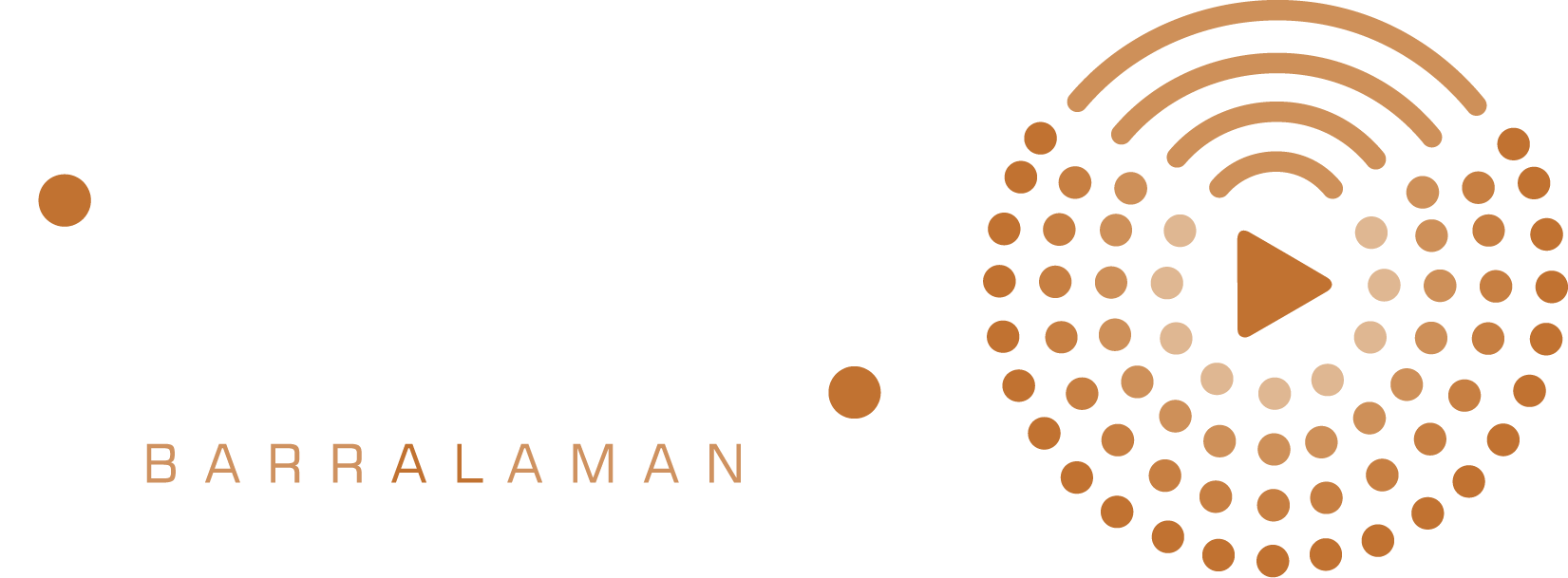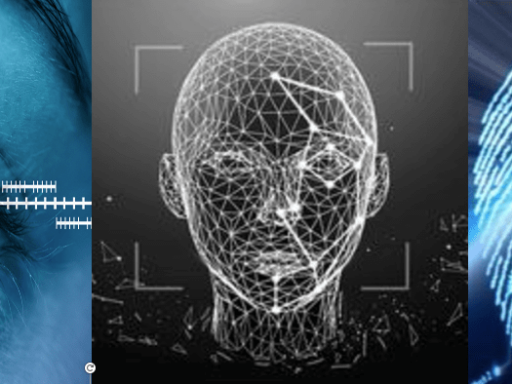Contents
La Tunisie a misé sur la modernisation de son agriculture pour accroître rapidement la productivité. Si cette stratégie a produit des résultats à court terme, elle a aussi engendré des coûts sociaux et environnementaux majeurs : les petits exploitants se trouvent de plus en plus marginalisés, les savoir-faire traditionnels s’effritent, et la durabilité écologique est sérieusement menacée. Cet article revient sur les effets de cette dynamique de modernisation, met en lumière les failles persistantes des politiques agricoles et des systèmes de données, et souligne l’urgence de redonner toute leur place aux agriculteurs locaux pour construire un développement à la fois durable et plus juste pour tous.
Quand la modernisation agricole révèle ses limites
Depuis son indépendance au milieu des années 1950, le développement agricole de la Tunisie a été façonné par une idéologie de modernisation, fortement inspirée des modèles d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. Portée par le parti Néo Destour — devenu le Parti socialiste destourien dans les années 1960 — cette orientation reposait largement sur l’expertise étrangère et l’appui de la coopération internationale, notamment dans le domaine agricole. L’idée directrice était que la science et les technologies modernes pouvaient apporter des solutions aux grands défis socio-économiques tels que l’insécurité alimentaire, le chômage et la pauvreté en milieu rural. Cette ambition a atteint son apogée avec l’adoption des pratiques issues de la Révolution verte lors de la campagne agricole 1967-1968, traduisant une réponse technocratique aux tensions[1] socio-politiques du moment.
Un exemple emblématique de cette stratégie est l’introduction de semences améliorées de blé tendre mexicain, mises au point par le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT). Ces semences ont permis d’accroître considérablement les rendements par rapport aux variétés locales, mais à un coût élevé : leur culture exige une forte consommation d’engrais chimiques, de pesticides et l’usage de matériels agricoles modernes, rendant les exploitations dépendantes de chaînes d’approvisionnement internationales. Ce bouleversement a fragilisé la biodiversité locale, érodé les savoir-faire et les pratiques agricoles traditionnels[2], et compromis la durabilité écologique à long terme.
Au fil des décennies, le poids du secteur agricole dans l’économie tunisienne s’est considérablement réduit. Dans les années 1960, l’agriculture représentait plus de 20 % du produit intérieur brut (PIB) ; en 2018[3], cette part était tombée à environ 10 %. Cette tendance se reflète également dans l’emploi : après l’indépendance, près de 40 % de la population active travaillait dans l’agriculture ; aujourd’hui, ce chiffre est tombé à seulement 15 %[4].
Cette régression s’inscrit dans un virage plus large vers des politiques économiques libérales amorcé dans les années 1970, qui ont misé sur une croissance tournée vers l’exportation. La mise en place des programmes d’ajustement structurel (PAS) au milieu des années 1980, puis la signature de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne en 1995[5], ont accentué cette orientation. Le PAS agricole a favorisé la libéralisation des prix et des investissements tout en facilitant la privatisation progressive des entreprises publiques du secteur. Si ces réformes visaient à moderniser l’économie et à attirer les capitaux étrangers, elles ont souvent fragilisé les petits exploitants et les communautés rurales, confrontés à des défis de plus en plus complexes dans un contexte de mutations rapides.
Ce basculement a creusé les inégalités, réduit la résilience de l’agriculture locale et marginalisé celles et ceux dont la subsistance dépend de ce secteur. Pourtant, malgré sa part décroissante dans la création de richesse nationale, l’agriculture reste vitale pour la vie rurale : elle fait vivre environ 470 000 agriculteurs[6], qui jouent un rôle essentiel dans la stabilité des campagnes et la sécurité alimentaire du pays.
Bien que 62 % des terres tunisiennes soient consacrées à l’agriculture, le secteur peine toujours à couvrir les besoins nutritionnels de la population. Le pays dépend de plus en plus des importations, notamment pour les céréales, les fourrages et des intrants essentiels tels que les semences, les produits chimiques et le matériel agricole. Cette dépendance croissante alimente de vives inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et à la souveraineté économique du pays, alors même qu’il s’agit d’un secteur vital pour la Tunisie.
La quête de gains de productivité à court terme, alimentée par la dynamique du marché international, a entraîné une dégradation écologique notable tout en creusant les inégalités sociales. Près de 80 % des ressources en eau[7] disponibles sont mobilisées pour l’irrigation[8], ce qui a provoqué une surexploitation inquiétante. Associée à l’appauvrissement des sols et à l’usage intensif d’engrais chimiques et de pesticides, cette situation a généré des dommages environnementaux majeurs, compromettant la viabilité à long terme du modèle agricole national.
L’un des principaux points faibles de la stratégie de modernisation tunisienne réside dans la déconnexion persistante entre les orientations politiques et la réalité quotidienne des agriculteurs sur le terrain. Cette fracture a accentué la marginalisation des petits exploitants, de plus en plus fragilisés par le désengagement de l’État de ses fonctions de régulation et par la domination grandissante des grandes entreprises sur le marché agricole[9]. L’accès au crédit[10] constitue un autre obstacle majeur : les études sur le financement du secteur révèlent que nombre d’agriculteurs ruraux peinent à mobiliser les ressources financières nécessaires pour moderniser leur exploitation. En conséquence, une large part de la population agricole reste exclue du système financier formel.
Ces difficultés sont renforcées par la sous-estimation de l’expertise locale et des savoir-faire traditionnels, trop souvent écartés au profit d’approches descendantes venues de l’extérieur. Ce manque de reconnaissance fragilise encore davantage la pertinence et l’efficacité des politiques agricoles, laissant les petits exploitants sans soutien adéquat pour surmonter les obstacles structurels et s’adapter à un environnement économique en constante évolution.
Combler le fossé : le rôle des données dans l’élaboration des politiques agricoles en Tunisie
Les politiques agricoles s’appuient largement sur les données produites par des institutions nationales et internationales, ce qui met en évidence l’importance cruciale d’un écosystème de données robuste et fiable pour concevoir, évaluer et ajuster efficacement les stratégies. Or, les statistiques ne sont jamais totalement neutres : elles traduisent souvent les priorités et les présupposés des acteurs qui financent et pilotent ces systèmes. Ce biais conduit à privilégier la croissance économique au détriment de la durabilité sociale et environnementale, en mettant l’accent sur les tendances macroéconomiques tout en passant sous silence la réalité des petits exploitants et des pratiques agricoles traditionnelles.
En Tunisie, l’écosystème de données agricoles repose essentiellement sur deux institutions : l’Institut National de la Statistique (INS) et l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI). Si ces organismes offrent une lecture fine des grandes tendances économiques, ils peinent encore à saisir toute la diversité et la complexité des situations vécues par les agriculteurs sur le terrain.
L’Institut National de la Statistique (INS), fondé en 1969 et rattaché au ministère du Développement et de la Coopération internationale, constitue l’autorité statistique de référence du pays. Il joue un rôle central en fournissant des données clés sur l’utilisation des terres, le nombre d’exploitations et la production agricole. À titre d’exemple, en 2023, la Tunisie comptait environ 515 548 exploitations agricoles pour une superficie totale de 10 452 740 hectares. Malgré sa mission indispensable, l’INS doit relever des défis majeurs, notamment sa forte dépendance à l’égard de financements et d’assistances techniques extérieurs. Un exemple parlant est l’accord conclu en 2023 avec l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et la Banque mondiale, dans le cadre du « Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund ». Cet accord a pour ambition de moderniser l’infrastructure statistique tunisienne en apportant une assistance technique renforcée et continue, afin de stimuler l’investissement dans les secteurs stratégiques. Selon un communiqué de l’AICS, ce soutien vise à « moderniser l’appareil statistique tunisien » grâce à une « assistance technique continue et renforcée », notamment dans les « secteurs prioritaires ». L’ambassadeur d’Italie a rappelé que cette coopération s’inscrit dans une « approche pragmatique et globale, répondant aux besoins réels du pays ». Pour leur part, le directeur de l’AICS et le représentant résident de la Banque mondiale ont insisté sur l’importance de moderniser le système statistique pour favoriser un développement durable et une croissance inclusive. Détail révélateur : le communiqué n’indique pas si un représentant de l’INS s’est exprimé lors de la signature de cet accord.
L’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), placé sous l’autorité du ministère de l’Agriculture, se concentre sur la collecte et l’analyse de données liées aux secteurs agricole et halieutique, couvrant notamment les céréales, l’élevage, la pêche ou encore l’huile d’olive. Bien que ses études s’adressent principalement aux décideurs, investisseurs et chercheurs, les données produites par l’ONAGRI mettent souvent l’accent sur les filières orientées vers l’exportation et dictées par les logiques de marché. Cette approche traduit une vision centrée sur la sécurité alimentaire et les incitations liées aux marchés internationaux, mais elle tend à négliger les besoins des petits exploitants et l’importance de l’autonomie alimentaire à l’échelle locale.
Après la transition politique de la Tunisie en 2011 et son adhésion au Partenariat pour un Gouvernement Ouvert[11], d’importants progrès[12] ont été accomplis pour améliorer la collecte de données et renforcer la transparence. Parmi ces avancées figure l’adoption de la loi n° 22 de 2016, qui a conduit à la création de l’Instance d’Accès à l’Information[13][14]. Cependant, malgré ces progrès, l’écosystème des données agricoles reste confronté à des défis structurels et d’accessibilité qui freinent son efficacité. La centralisation de l’administration tunisienne accentue les inégalités régionales, laissant les zones rurales et isolées à l’écart en matière d’accès aux données. De plus, les procédures complexes et chronophages pour obtenir des informations écartent souvent des acteurs clés, notamment les petits exploitants, généralement peu familiers des démarches bureaucratiques.
Ces difficultés sont aggravées par la baisse du financement public et les mesures d’austérité imposées par le FMI, qui ont gravement affecté le fonctionnement d’institutions telles que l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA). Historiquement, l’AVFA jouait un rôle essentiel en soutenant les agriculteurs : visites de terrain régulières, distribution de supports d’information, organisation d’événements communautaires pour partager connaissances et innovations. Aujourd’hui, cette proximité s’est fortement réduite, laissant de nombreux agriculteurs frustrés par le manque de soutien et l’accès limité à des informations cruciales.
Ce fossé grandissant entre les institutions agricoles et les besoins des communautés qu’elles sont censées servir souligne l’urgence de bâtir un écosystème de données plus inclusif et ancré dans les réalités locales. Si la modernisation de l’écosystème des données agricoles en Tunisie — promue par des institutions internationales — reste indispensable pour améliorer la collecte, l’accès et le traitement des données, la manière dont elle est mise en œuvre suscite des inquiétudes. Les accords de financement qui soutiennent ces initiatives comportent souvent des conditions et des priorités dictées par les bailleurs, qui ne coïncident pas toujours avec l’objectif de promouvoir une agriculture équitable et inclusive en Tunisie. Ce décalage risque de renforcer les inégalités existantes dans le secteur, où les communautés rurales sont déjà marginalisées en termes de ressources.
La modernisation ne doit pas être un simple exercice technocratique guidé par des priorités extérieures, mais bien un processus qui donne du pouvoir aux petits exploitants, valorise les savoirs locaux, soutient les communautés rurales et renforce leur résilience face aux contraintes économiques et écologiques plus larges du pays.
Vers un écosystème de données agricoles plus inclusif
Pour surmonter ces défis et construire un système de données agricoles plus équitable, la Tunisie doit :
-
- Décentraliser la collecte et l’analyse des données : Donner aux acteurs régionaux et locaux les moyens de contribuer activement à l’écosystème des données, afin qu’il reflète la diversité des réalités rurales et des petits exploitants.
- Donner la priorité aux besoins locaux : Passer d’une logique centrée sur l’exportation à un soutien renforcé à l’agriculture durable de petite échelle et aux systèmes alimentaires locaux.
- Associer les agriculteurs et les praticiens du secteur : Impliquer directement les agriculteurs dans la collecte de données, l’élaboration des politiques et les processus de décision pour ancrer les politiques dans l’expérience concrète du terrain.
- Renforcer l’accessibilité et la transparence : Simplifier les procédures administratives afin de rendre les données plus accessibles à tous les acteurs, en particulier aux petits exploitants et aux communautés marginalisées.
En comblant ces lacunes, la Tunisie pourra mettre en place un cadre de politiques agricoles plus équilibré et inclusif, qui soutienne la croissance économique tout en préservant l’équité sociale, la durabilité environnementale et la souveraineté nationale. Cette approche permettra non seulement de rendre les politiques plus efficaces, mais aussi de rétablir la confiance entre les institutions agricoles et les communautés qu’elles accompagnent.
—
References
[1] Cornilleau, L., and P. Joly. “La Révolution Verte, Un Instrument de Gouvernement de La « faim Dans Le Monde ». Une Histoire de La Recherche Agricole Internationale.” Le Gouvernement Des Technosciences: Gouverner Le Progrès et Ses Dégâts Depuis 1945, Dominique Pestré, La découverte, 2014, pp. 171–201.
[2] Ajl, M., & Sharma, D. (2023). The Green Revolution and transversal countermovements: Recovering alternative agronomic imaginaries in Tunisia and India. *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d’études Du Développement*, 43(3), 418–438. https://doi.org/10.1080/02255189.2022.2052028
[3] World Bank Data, Tunisia: https://data.worldbank.org/country/TN
[4] « Emplois par secteur économique en Tunisie 2008 – 2018 [archive] », sur fr.statista.com
[5] Mohamed Salah Bachta et Anouar Ben Mimoun, « Libéralisation des échanges, agriculture et environnement en Tunisie », *Options Méditerranéennes*, no 52, 2003
[6] Ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. (2021). Projet Annuel de Performance de La Mission Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Pour l’année 2022. http://www.gbo.tn/sites/default/files/2022-01/PAP%202022%20Agriculture.pdf
[7] “Tunisia | Water Efficiency, Productivity and Sustainability in the NENA Regions (WEPS-NENA) | Food and Agriculture Organization of the United Nations.” https://www.fao.org/in-action/water-efficiency-nena/countries/tunisia/en/
[8] “Water Use in Tunisia.” Fanack Water. https://water.fanack.com/tunisia/water-use-tunisia/
[9] Gasmi, Haithem, and Roxanne Dovdar. من أجل نظام فلاحي وغذائي صامد ومستدام وشامل. Consultation, AFSA, June 2021. https://drive.google.com/file/d/16lQNI6_-EMxopALzE-CNubseeN_Tpapu/view?usp=drive_link
[10] Foltz, Jeremy D. (2004). “Credit Market Access and Profitability in Tunisian Agriculture.” *Agricultural Economics*, 30(3), 229–240. https://doi.org/10.1016/j.agecon.2002.12.003